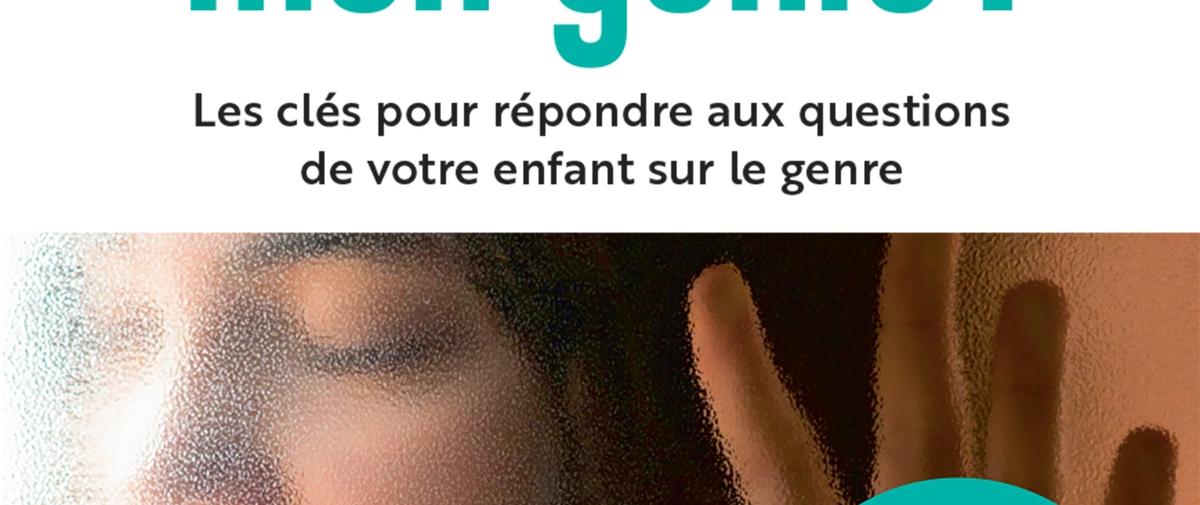Comment répondre à un enfant qui s'interroge sur son genre ?
Dans C’est pas mon genre !, à paraître le 9 février, la psychiatre Anne Bargiacchi, apparue dans le documentaire Petite fille, délivre des clés de compréhension aux parents, afin qu’ils accompagnent au mieux leur enfant dans ses questionnements.
Que répondre à un enfant qui se questionne, montre qu’il ne se sent pas bien dans son corps de garçon ou de fille ? Dans son ouvrage C’est pas mon genre ! (1), à paraître le 9 février aux éditions Marabout, la psychiatre Anne Bargiacchi donne des clefs de compréhension aux parents ne sachant pas comment réagir, se sentant perdus, voire impuissants. Pendant dix ans, la médecin a été responsable de «la consultation pour les jeunes expansifs de genre» (comprenez pour les jeunes dont les rôles ne correspondent pas aux stéréotypes féminins ou masculins).
Cette ancienne cheffe de clinique des Hôpitaux de Paris est notamment apparue dans le documentaire Petite fille, de Sébastien Lifshitz. On l’y voit discuter avec Sasha, qui se sent petite fille depuis l’âge de 3 ans, mais est née dans un corps de garçon. Diffusé sur Arte en décembre 2020, le film avait rassemblé près d’1,4 million de téléspectateurs. Le Dr. Anne Bargiacchi, qui vit désormais aux États-Unis, se dit «heureuse» que le film ait pu «augmenter la visibilité» des personnes transgenres, et fait «découvrir un sujet mal connu» à certains téléspectateurs. Dans C’est pas mon genre !, elle poursuit son travail de pédagogie et prône la tolérance. Interview.
En vidéo, « Petite fille », la bande-annonce du documentaire
Madame Figaro.- Qui sont vos patients, et comment abordent-ils avec vous les questions liées au genre ?
Dr. Anne Bargiacchi. – Beaucoup sont âgés de 12 à 14 ans, et ils commencent à faire des recherches sur Internet. Ce n’est pas le cas de tous mais certains tapent par exemple «fille dans un corps de garçon», ou «garçon qui se sent fille». Ils posent des questions sur l’expression et les rôles de genre, plus que sur l’identité de genre (le sentiment intime et profond d’appartenir au genre féminin ou masculin, un mélange des deux ou à aucun, quel que soit son sexe biologique, NDLR). D’autres, âgés de 16 à 17 ans, cherchent à savoir comment s’exprimer rapidement dans le genre auquel ils se sentent appartenir. Dans le cas des très jeunes enfants, ce sont les parents qui ont constaté des comportements non-conformes aux stéréotypes de genre. Les petits, eux, ne remettent pas toujours en question celui qui leur a été attribué à la naissance, ou pas encore. À l’inverse, certains prient tous les soirs pour se réveiller dans le bon corps.
Dans votre ouvrage, vous parlez de la dysphorie de genre. Pouvez-vous définir le terme ?
Il s’agit de la souffrance spécifiquement liée à ce sentiment d’incongruence entre le genre attribué à la naissance et celui auquel on se ressent appartenir. Cette souffrance peut venir du fait d’être mégenré (se voir désigner par un pronom ou des accords qui ne sont pas ceux que l’on souhaite, NDLR) dans la société, d’avoir des attentes que l’on ne remplit pas vis-à-vis de soi-même (être toujours renvoyé au fait que notre corps ne nous ressemble pas, notamment), ou encore venir d’un sentiment de dissonance interne. La dysphorie de genre a remplacé l’expression de «trouble de l’identité de genre», inscrit dans le Manuel diagnostique des troubles mentaux (DSM) jusqu’en 2013. La plupart des personnes spécialisées dans la prise en charge de personnes transgenres, s’entendent pour dire qu’être transgenre n’est pas une maladie, mais que la souffrance spécifique du patient nécessite un diagnostic.
« C’est pas mon genre ! », du Dr. Anne Bargiacchi, donne aux parents les clés pour soutenir leur enfant, et l’accompagner dans son exploration des genres. (2022.)
Des discussions au quotidien
À quel âge un enfant peut-il commencer à s’interroger ?
Entre 2 et 3 ans, les enfants commencent à prendre en compte la façon dont l’environnement est organisé autour de cette idée des genres. Ils réalisent qu’il y en a deux, a priori, et que la plupart des personnes appartiennent à l’un ou à l’autre. Jusqu’à 6 ans, ils commencent à catégoriser, à trier, à donner du sens à leur environnement. D’un point de vue développemental, il semble que pour certains, l’âge auquel l’identité de genre commence à se stabiliser au plus tôt, est 6 ou 7 ans.
À quel moment, en tant que parents, doit-on sérieusement y prêter attention ?
Un enfant prêt va poser des questions. Si nous ne connaissons pas la réponse, le simple fait de dire qu’il pose une bonne question et que nous allons y réfléchir, est déjà très bien. L’enfant doit comprendre qu’il n’est pas honteux de ressentir ces émotions, que ses parents sont présents s’il a besoin d’en parler lors de petits échanges, au quotidien. On peut également souligner que ces interrogations ne sont ni un signe de maladie, ni un signe de bizarrerie.
Comment réagir face à une demande de transition ?
De manière générale, les coming-out sont rarement accompagnés d’une demande de transition directe. Si les enfants et ados l’envisagent, elle sera mûrie par la suite. Lorsqu’ils formulent une demande de transition inattendue, il est important de rappeler à l’enfant qu’il existe plusieurs façons de faire. Il pourra d’abord opérer une transition sociale, soit tout ce qui est en rapport avec le changement de prénom, de pronom et donc de genre dans les accords grammaticaux. En pratique, cela englobe la façon dont ils sont appelés et genrés au sein de la famille ou de l’école, comment ils s’habillent, se coiffent, les rôles sociaux qu’ils peuvent adopter, et les changements légaux, comme celui du prénom sur l’état civil. L’enfant pourra, ou non, envisager ensuite une transition médicale.
Comment se passe une transition sociale, en pratique ?
Cela passe par des essais, et parfois, des erreurs. Les ados peuvent faire des tests, notamment changer de vêtements ou de pronom(s), d’abord avec certains copains, ou bien juste avec leurs parents. Lorsqu’ils font ces explorations, il est important de les encourager à écouter leur ressenti, plutôt qu’à se demander comment cocher des cases. Je conseille aux parents de se renseigner le plus possible, et d’expliquer à leur enfant qu’il a le droit de revenir en arrière, et que ce n’est pas grave. On peut aussi recommander à l’enfant de se concentrer sur ce vers quoi il voudrait aller, plutôt que de penser tout le temps à ce qu’il voudrait voir disparaître chez lui.
Lea T est un modèle transgenre de 34 ans et la muse depuis 2010 de Riccardo Tisci, le directeur artistique de Givenchy.
Annoncée en 2011, l’opération de la jeune femme a eu lieu l’année suivante. Habituée des défilés et magazines de mode, Lea T est aussi l’un des visages de la marque de produits pour cheveux Redken. (Sao Paulo, le 17 avril 2015.)
Modèle pour l’agence Elite, Carmen Carrera a révélé être transgenre au grand public en 2012.
L’année suivante, une pétition a circulé sur Internet, demandant à Victoria’s Secret, la célèbre marque de lingerie, d’engager Carmen Carrera comme premier mannequin transsexuel. Malgré les 45.000 signatures, la marque n’a pas donné suite. (New York, le 17 septembre 2015.)
Tyler Ford a 24 ans et le look d’un ado accro à Tumblr. Ils – Tyler Ford veut qu’on parle de lui à la troisième personne du pluriel – se présentent comme « écrivain, orateur, consultant, mannequin et personnalité transgenre ».
On les a notamment aperçus dans The Glee Project 2. Ils sont conseillers pour la jeunesse LGBT sur la chaîne américaine MTV et ont travaillé avec Miley Cyrus pour son association, Happy Hippie Foundation, qui vient en aide aux jeunes LGBT. (New York, le 16 juin 2015.)
L’actrice américaine a été révélée au grand public grâce à son rôle dans la série à succès Orange Is the New Black. Elle y interprète le rôle de Sophia Burset, une femme transgenre, en prison pour fraude à la carte de crédit. Un rôle majeur pour cette personnalité très engagée dans la cause LGBT et première tansgenre à figurer en couverture du Time. (Los Angeles, le 28 juin 2015.)
Transmettre l’amour inconditionnel
Les parents vont parfois commettre des erreurs, des maladresses. Quelles sont les critiques et attitudes à éviter lorsque l’enfant s’interroge ?
Il est impératif de ne pas recourir à la honte. Si un parent fait appel à l’amour ou à la déception pour inciter son enfant à changer, et sous-entend que le ressenti de l’enfant n’est pas valide ou qu’il faut le taire, cela sera contre-productif. Cela aura un impact sur la manière dont l’enfant l’exprime, sur son estime de soi et son aptitude à prendre soin de lui.
Que faire si l’on sent que l’on a heurté son enfant ?
Il est très important de le reconnaître et de présenter ses excuses. Il s’agit de transmettre l’amour inconditionnel que l’on éprouve pour la personne qu’il est, pas pour celle que l’on espérait le voir devenir. Il faut aussi éviter toute forme de violence, qu’elle soit physique, morale ou verbale, ainsi que les manipulations plus subtiles, même si c’est «pour le protéger».
C’est-à-dire ?
Par exemple, si un adolescent veut s’habiller en fille pour aller à une soirée, et que l’on trouve cela dangereux, il faut être clair sur ce qui nous pousse à dire «non». Si les parents se disent soutenants, il faut que leurs actes soient en adéquation avec leur mentalité, et être capable de dire «oui» de temps en temps, pour permettre à l’adolescent d’expérimenter. Certes, les parents sortent de leur zone de confort, et cela peut faire très peur, mais la conviction que malgré cette peur, il est possible d’y arriver, va permettre à l’enfant de faire face au danger.
Dans le documentaire Petite fille, l’école de Sasha peine à comprendre sa situation. Comment expliquer les réticences de certains établissements scolaires ?
Je pense que c’est un sujet très mal compris. Il suscite parfois des réactions de peur. Il y a des établissements scolaires ou extra-scolaires qui se positionnent en défenseur de l’enfant, qui le pensent en danger. Il y a alors tout un travail d’éducation à faire, pour les aider à recueillir les bonnes informations. Nous encourageons souvent les parents à partager des liens, des documents qui peuvent ouvrir le dialogue. Quand le partage d’informations n’est pas suffisant, il faut faire appel à des professionnels issus d’associations spécialisées ou bien à des professionnels médicaux.
(1) C’est pas mon genre !, du Dr. Anne Bargiacchi, à paraître le 9 février 2022, Éd. Marabout, 256 p., 19€90
Source: Lire L’Article Complet